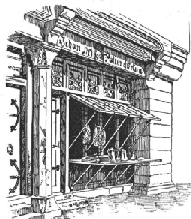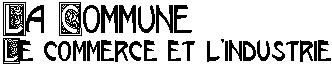 |
|
|
On peut considérer le Xe siècle comme point de départ des industries locales. Saint-Quentin, dès le XIIe siècle, possède une industrie textile qui fait vivre bon nombre d'habitants et dont la charte fait mention. Les nombreux articles de la charte consacrés à l’activité économique, et en particulier textile montre leur importance. La principale production est la sayette rie, nom donné à l'ensemble des tissus : serges et croisés, toutes étoffes de laine filée au rouet (appelé sayette) mais très légères et destinées aux classes pauvres. Le camelot est un mélange de laine, de soie, de fil et de poils de chèvre. Cette activité se double de la fabrication de toiles de lin ou de chanvre. La qualité des tissus est sévèrement contrôlée. Les corporations désignent des experts ou "égards" qui jugent de la valeur de la fabrication, découvrent toute malfaçon dans le foulage, le cardage, le tissage ou la teinture des laines. Toute fraude se voit sanctionnée : les mesures prises vont de l'amende à la destruction de la pièce défectueuse ou les deux à la fois. Ainsi, la qualité de ce qui se vend est-elle assurée pour l'acheteur et les tissus de Saint-Quentin s'achètent jusque dans les foires de Brie ou de Champagne, malgré les droits de péage qui sont un obstacle auquel le conseil municipal s'efforce de remédier par des accords avec les différents receveurs. Le négoce en souffre, mais se développe d’année en année. La ville a donc déjà une aristocratie qui doit son aisance au textile. Sa richesse s'extériorise surtout par une garde-robe abondante plus encore que par l'aménagement extérieur ou intérieur des demeures. Les marchands utilisent aussi leur argent à acheter des terres qu'ils louent aux fermiers contre une redevance en nature. D’autres productions artisanales sont présentes (le travail du cuir, en particulier), ainsi que le commerce du blé qui constitue une source de revenus non négligeable. Saint-Quentin reste avant tout une ville drapante. Elle fait partie d’un groupement, les dix-sept villes, qui sont en réalité vingt-quatre, constitue pour faciliter le commerce vers les foires de Champagne. |
|
| Car le moyen-âge
a compris tout l’intérêt d'organiser des
marchés et des foires. Les rois et les seigneurs cherchent à
les faire vivre pour des raisons très
simples : les droits perçus sur les marchandises. Les
marchands payent en effet de lourds péages
sur les routes, sur les ponts, et dans les villes. A Saint-Quentin, le
marché a lieu chaque semaine, ainsi qu’une foire à Pâques, qui
dure 16 jours. Et, à partir de 1319, la foire de St Denis qui est fixée
au 9 octobre, jour de la Saint-Denis. Le roi permet l'exemption de
tous les droits aux participants de cette foire.
Sur la place de Saint-Quentin, le commerce des graisses est actif car elles entrent dans une notable proportion dans l'alimentation. On entend par graisse le lard salé, l’huile, le fromage, le miel, le suif, etc. . .Les poissons sont abondants : hareng, maquereau, saumon, raie, anguille, aiglefin, etc…. |
|
 La Foire de la Saint-Denis
La Foire de la Saint-Denis