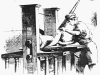 Parmi
les trésors qui constituent le fonds local de la bibliothèque municipale de
Saint-Quentin, j'ai trouvé d'intéressants documents permettant d'évoquer
deux siècles de l'histoire des maîtres imprimeurs de notre ville.
Parmi
les trésors qui constituent le fonds local de la bibliothèque municipale de
Saint-Quentin, j'ai trouvé d'intéressants documents permettant d'évoquer
deux siècles de l'histoire des maîtres imprimeurs de notre ville.Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet je pense qu'il est intéressant de parler de l'invention de l'imprimerie qui ne date que du 15° siècle.
Pour cette première partie de mon article, je trouve tous les éléments nécessaires dans une intéressante conférence faite en décembre 1984 à la société académique par Mme Martine Grelle, notre bibliothécaire et son adjoint, M. François Berquet.
Ils disaient entre autre: Gutenberg est l'inventeur de la typographie en Occident, Il est né à Mayence en 1397 dans une famille d'orfèvres où il s'initie à la technique des métaux.
Installé à Strasbourg, il continue secrètement ses recherches pendant vingt ans. De retour à Mayence en 1448, il trouve un commanditaire,
Jean Fust et complète son équipe avec le calligraphe Peter Schoetter. Ils préparent ensemble leur premier livre imprimé .. La Bible en 42 lignes °.
Nos conférenciers nous disent aussi que la création des caractères mobiles exigeait trois étapes
a) une gravure en relief du signe sur acier,
b) son impression sur métal moins dur (cuivre ou laiton).
c) coulage du caractère par fusion
Nous évoquerons aujourd'hui les
imprimeurs typographes de SaintQuentin parmi lesquels la dynastie des
Lequeux qui régnait sur l'imprimerie saint-quentinoise de 1615 à 1715, comme
le signalaient Mme Martine Grelle et M. François Berquet, que je dois
remercier ici de m'avoir donné l'idée d'écrire ce document.
Un exemple de décision royale
Vous verrez plus loin que le premier imprimeur-libraire de SaintQuentin
semble s'y être installer vers 1625. Mais avant d'entrer dans notre histoire
saint-quentinoise, je voudrais vous donner le texte d'une ordonnance royale
du 5 juillet 1649 autorisant la création à Laon de la première imprimerie.
Je le donne surtout à titre d'exemple de la forme des textes légaux du 17°
siècle, sous Louis XIV
« Louis, par la grâce du Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui
ces présentes lettres verront. Scalut, pour empêcher lés abus et !es
faussetés qui se pourraient commettre en l'impression des livres et de nos
édits, déclarations, arrêts et affaires communes de nos bonnes villes, nos
prédécesseurs ROYS auraient établis en icelles. des imprimeurs de bonne vie,
preudomie et intégrité, lequel établissement n'ayant encore eté fait en
notre bonne ville de Laon, aune des principales (?) de notre province de
Picardie, notre cher et BIEN aimé Pierre Brizart, maître-impnmeur, y aurait
fait faire une presse avec les outils et instruments nécessares pour
l'imprimerie, afin d'y en `aire l'exercice, et ayant présenté requête aux
prévosts et juges ordinairees de ladite ville pour avoir permission d'y
travailler dudit art de librairie, le dit prévost, par acte du 29 mai de
//dures, meure tous édits, déclarations, arrêts de nos conseils et cour
souveraine et tous actes concernant les affaires communes des corps de
ladite ville et dudit diocèse, privativement 9 tout autre et ce, tant
qu'il nous plaira, etc.
Donné à Compiègne, le 5 juillet de l'an de grâce 1649. Cette ordonnance fut
enregistrée à Laon, sur le registre des chartes le 20 septembre 1649, et
enquête a été faite ensuite sur les bonnes vie et moeurs de l'impétrant, le
sieur Pierre Brizart.
Après ce simple exemple d'ordonnance autorisant l'installation d'une
imprimerie à Laon, nous entrons dans Saint-Quentin vers 1625 avec Charles
Lequeux, qui semble tenir la tête des imprimeurs dans notre ville.
Las Lequeux imprimeurs à St-Quentin
Charles Lequeux
Dans l'ordre chronologique, c'est le premier imprimeur saint-quentinois sur
lequel nous possédons quelques renseignements.
II est originaire de la petite ville de Guise. Dans son pays d'origine, il
est procureur et notaire. II n'était donc préparé en aucune façon à la
profession d'imprimeur. On est donc surpris, étant donné les règles
corporatives, qu'il installe un atelier typographique à St-Quentin en 1615.
II faut quand même préciser que l'invention de l'imprimerie ne date que du
milieu du 15° siècle, et il semble que notre ville ne possède pas
d'imprimerie avant son arrivée.
La date de son installation a StQuentin n'est d'ailleurs pas précise,
car Claude de Lafons la fixe en 1625.
En 1627, il édite un livre de Claude Hemeré pour lequel il avait reçu le
privilège le 23 mars 1627.
Ce dernier, aurait ordonné que le dit Brizart se pourvoirait par devant
nous, pour obtenir nos lettres de provision de ladite charge d'imprimeur et
libraire. Savoir faisons qu'après avoir fait voir en notre conseil ledit
acte du 20 mai dernier etc... avons octroyé et octroyons l'état et charge de
notre imprimerie et librairie en notre ville et diocèse de Laon, pour en
jouir et user par ledit Brizart aux mêmes honneurs, fonctions et.....
En 1631, sort de ses presses « Coutumes générales dû baillage du Vermandois
n de Claude de Lafons. Charles Lequeux meurt en 1647.
Claude Lequeux
Fils du précédent auquel il succède à sa mort. II s'intitule lui-même
Vers 1680, pour des raisons ignorées, Claude Lequeux quitte la rue
Saint-André pour s'installer «Au Lion dArgent »
Pour compléter notre petite histoire nous devons signaler que son
fournisseur de papier d'imprimerie était son gendre, le sieur François
Bonnard, dont l'atelier se trouvait dans un petit village, à quelques lieues
de notre ville: Mézières-surOise.
Claude Lequeux fut l'éditeur du Miroir d'Origny » par le R.P, Pierre de
Saint-Quentin, prédicateur capucin.
Notre imprimeur est mort à SaintQuentin le 29 août 1683. C'est sa veuve,
dont nous ignorons le patronyme qui lui succède et dirige l'atelier jusqu'en
1702.
Francois Lequeux
Fils des précédents. II est né a Saint-Quentin le 14 septembre 1677. A l'âge
de 25 ans, il succède à sa mère, par autorisation municipale du 28 juillet
1702. IL meurt à Saint-Quentin le 10 avril 1715
A sa mort, l'imprimerie Lequeux disparaît suivant une décision juridique du
26 janvier 1712.
La dynastie des Lequeux s'étend donc avec lUI.
François César Coton
Imprimeur à Laon et St-Quentin
(1703 - 1721)'
II est né à Laon le 1°' mai 1679. II fait son apprentissage à Soissons et
obtient le droit d'établir un atelier typographique à Laon le 10 février
1701. Mais le lieutenant général fait appel à cette décision et il lui faut
attendre l'arrêt favorable du 22 janvier 1703, pour exercer son art.
Son établissement n'étant pas muni des deux pressés réglementaires, il est
invité par un arrêt du Conseil le 25 novembre 1709 à se mettre en règle
Tous les malheurs lui tombent sur la tête. Le voilà condamné à 100 livres
d'amende pour avoir imprimé un « libelle qui lui aurait été commandé
par le maÏtre de postes de Laon. Heureusement, il est amnistié par un arrêt
du 20 octobre 1710. Pourtant, le voilà ruiné et il cède son atelier à la
veuve Rennesson et à son neveu le sieur Meunier (arrêt du Conseil d'Etat du
26 janvier 1711) cet arrêt autorise en outre le sieur F.C. Coton à s'établir
imprimeur-libraire à Saint-Quentin aux lieu et place de feu Claude Lequeux.
Le sieur Coton débarque à SaintQuentin où il est commandité par Demoiselle
Nicolle Bonnet... Mais un nouveau nuage lui passe sur la tète. Claude
Lequeux, le fils de François conteste la décision du 26 janvier 1711. Sa
famille exerce l'imprimerie à St-Quentin depuis un siècle. II a été apprenti
chez son père, auquel il a succédé en vertu d'une décision échevinale du 28
juillet 1702. La décision du Conseil d'Etat est donc caduque...
On ne sait trop ce qui fut dit ou ce qui fut fait, mais une nouvelle
sentence du 26 janvier 1712 autorise F,C. Coton à continuer à exercer à
St-Quentin et laisse à François Lequeux «La charge de son père mais au décès
de l'un d'eux, la place sera close...
Dix ans plus tard, F. C. Coton laissait son affaire à Pierre Boscher et ce
dernier épousait Nicolle Bonnet.
Pierre Boscher Imprimeur à St Quentin (1721 - 1745
Nous ne connaissons rien de ses origines, II aurait « travaillé pendant
quinze années chez les meilleurs imprimeurs libraires »... et en 1720, il
demande a être reçu imprimeur dans votre ville.
II se marie avec Nicolle Bonnet qui était associée avec le sieur César
François Coton et à la faveur de ce mariage, ce dernier abandonne son fond à
Nicolle Bonnet.
P. Boscher ne prend possession de l'imprimerie qu'après la décision du
Conseil en date du 6 septembre 1721. L'imprimerie était alors installée dans
la rue des Talles.
En 1724 sort de ses presses: « L'oraison funèbre de Madame Agnès Catherine
de Grület de Brissac, abesse d'Origny-sainte-benoîte, par M. Wity, chanoine
d'Origny Sainte Benoîte».
En 1731, le sieur Pierre Lequeux, frère de François Lequeux attaque l'arrêt
du 6 septembre 1721. Mais il est débouté par le Conseil d'Etat le 15 février
1732.
Ce Pierre Lequeux était né à St Quentin le 8 novembre 1675. Il avait donc 57
ans.
En 1733. Pierre Boscher demande une instance contre les épiciers, merciers
et autres marchands de Saint Quentin qu'il accuse de vendre des livreS, à
son préjudice.
Le 18 novembre 1733, le lieutenant-général de police fait droit à la demande
de P. Boscher.
Les épiciers, mécontents de cette sentence, vont en appel, mais le Parlement
de Paris en ordonne l'exécution. Interdiction est donc faite aux marchands
de Saint-Quentin de vendre aucun livre,et imprimés
LE DÉPOT LÉGAL
Le dépôt légal, c'est une obligation faite aux imprimeurs et éditeurs de
déposer un certain nombre d'exemplaires de tout ce qui est imprimé à un
organisme officiel. MM. Laffont et Bompiani, dans leur « Dictionnaire
universel des Lettres » (Bordas éditeur) nous disent que ce dépôt légal a
son origine dans une lettre patente de François 1°' d'octobre 1537, qui
prescrivait aux 'imprimeurs de déposer, au moment de la publication de tout
imprimé, un exemplaire entre les mains du bibliothécaire royal.
De nombreuses lois vinrent confirmer et renforcer cette mesure, surtout dans
un but de censure e: de police. Nous en citons les
dates : 5 novembr181021 octobre 1814, 29 juillet 1881 et 19 mai
1925 . ... .. .. ..
Actuellement les imprimeurs sont tenus de déposer deux exemplaires au
ministère de l'Intérieur (pour Paris) et aux préfectures ou sous-préfectures
pour les départements.
Quant aux éditeurs, ils devaient adresser quatre exemplaires à . la
bibliothèque nationale et un au ministère de l'Intérieur.
Pieerre Boscher meurt en 1715. leurs candidats sollicitent la place vacante,
sa veuve, forte des droits que lui confère la législation continue a
exploiter son entreprise jusqu'au 7 octobre 1750.
Gabriel Osmont Imprimeur-libraire à Saint-Quentin (1751 - 1761) Serait né à
Paris le 26 octobre 1704. A la mort de Pierre Boscher, il dirige
l'imprimerie de la veuve de ce dernier. Le 7 octobre 1750, elle démissionne
en sa faveur. II est l'objet d'une décision favorable du Conseil d'Etat le
21 juin 1751.
II meurt le 6 mai 1761 et sa veuve Anne-Marie Henriette Watier, continue son
activité jusqu'en 1764. Elle avait deux presses, un compagnon et même
parfois deux. Julien Coru De La Goierie Imprimeur-libraire à St-Quentin
(1765 - 1769)
Nous ignorons son lieu de naissance. Nous ne connaissons pas sa
qualification, ni son lieu d'apprentissage. Ce qui est certain, c'est qu'il
convole en justes noces vers 1766 avec Anne-Marie Henriette Watier.. veuve
de feu l'imprimeur Gabriel Osmont et que celle-ci démissionne de son
privilège le 21 janvier 1770. suivant acte passé devant M° Désains et un
autre de ses confrères, notaires royaux à Saint-Quentin, après son second
veuvage survenu en 1769.
Etant donné l'absence-de preuves sur la qualification exacte du sieur
Michel-Julien Coru De Goierie, on peut alter jusqu'à penser qu'il était
peut-être typographe du cité de la cuisse. Ce qui semble anormal en ces
temps de rigueur corporative, mais il était quand même le conjoint d'un
maitre imprimeur de droit.
FRANÇOIS-THEODORE HAUTOY Imprimeur-libraire à Saint-Quentin (1770 - 1793)
C'est en sa faveur qu'avait été signé l'acte de vente de l'imprimerie
librairie de la veuve Coru De La Goirie du 21 janvier 1770• qui avait
été confirmé par un arrêt du Conseil en date du 27 octobre 1770.
Merci Paul pour tout ce que tu as
apporté a l'histoire de notre ville et pour tous ces
publications que tu m' adonnés/ je veux en faire profiter tous tes
amis
En 1831 et 1833 le choléra sévit à SAINT –QUENTIN comme dans toute la France
Le 9 Avril, un homme ayant séjourné à Paris pendant vingt-quatre heures entre à l'Hôtel-Dieu. Quatre jours plus tard, il meurt. Le 20, une femme, deux femmes, vingt individus, sont atteints de la maladie dans la même rue Saint-Nicaise, insalubre parce que pauvre. Les vents du sud et du sud-ouest, les pluies abondantes favorisent la maladie. Elle gagne les masures assises le long de l'abreuvoir Saint-Martin, Oestres. Elle s'approche de la ville par la rue d'Orléans, la petite rue Saint-Martin qu'elle ne dépasse pas.
Fin mai, elle atteint le faubourg de la Chapelle, la rue Sainte-Anne, le boulevard Richelieu, la rue neuve Saint-Jean et le faubourg Saint-Jean. Le choléra entoure la ville sans pénétrer à l'intérieur. Il sévit dans la classe malheureuse, mal logée, souffrant de privations. Trois cas seulement sont relevés chez les gens aisés et aucun ne sera mortel. Les ravages de la maladie s'arrêtent à la fin de septembre. Elle s'est développée en trois périodes bien marquées, chacune durant trois semaines environ. Au début de chaque période, tous les malades succombaient. A peine huit ou dix jours écoulés; on les voyait guérir en plus grand nombre. Pour toute la ville, 240 personnes furent atteintes du choléra dont 118, à peu près la moitié, moururent. A l'époque, on relève que le choléra est contagieux, épidémique, sans savoir pourquoi.
M. Loyson, sous-préfet de Saint-Quentin, va constater, avec M. Bourbier, l'auteur de l'article, le genre de maladie dont souffre un homme reçu dans une petite auberge du Câtelet. Celui-ci meurt du choléra, enveloppé d'une odeur fade et nauséabonde. Quatre jours plus tard, le sous-préfet subit une attaque violente du mal. Il en réchappe au moyen d'un traitement très actif.
D'après le Chevalier de Bucelly d'Estrées, l'Hôtel-Dieu fut créé pour les pélerins venus, par dévotion, au tombeau de Saint-Quentin. Autrefois, il comprenait 36 lits, moitié pour les hommes, moitié pour les femmes, séparés par un grille de bois. Le nombre de lits est maintenant porté à 60. D'autres oeuvres s'occupent des malheureux. Ainsi les « Orphelins » et « La Charité » reçoivent 60 enfants des deux sexes, nés de « légitimes mariages ». Ces enfants apprennent un métier à l'extérieur. Les « béguinages » comptent 44 loges réparties en trois lieux. De vieilles personnes y habitent gratuitement ; elles reçoivent des secours en argent et en nature. L'Hospice des « Vieux Hommes », fondé en 1744, abrite 24 pensionnaires. Le Chevalier rappelle le testament du chanoine Jacques de Chantrel qui, en 1666, légua des propriétés rapportant 240 setiers de blé. La vente du blé dote 7 jeunes filles vertueuses. L'auteur termine par une statistique détaillée, et insiste sur la nécessité d'agrandir l'Hôtel-Dieu.
article Socièté Académique de SAINT QUENTIN
le saviez vous
En 1837 la ville de Saint Quentin ne possédait qu'une école communale pour 20.000 habiants . L'Ecole n'est pas offerte aux filles malgré le développement de l'industrie et on remarque que 2104 enfants de 6 à 16 ans sont "analphabétes " surtout dans les Faubourgs