A la cour de nos anciens rois, la charge du queux ou cuisinier n'était pas une des moindres ; comme beaucoup d'autres, celle du sénéchal, par exemple, elle dévia de son but primitif, et devint un office politique confié à de grands feudataires dont le moindre souci était bien le soin des sauces et la préparation des banquets.
Aussi ce cuisinier nominal s'entoura-t-il d'une nuée de valets et d'aides, dont l'utilité pratique n'était point toujours suffisamment démontrée, mais qui avaient sur le maître queux l'incontestable avantage de mettre, selon l'expression vulgaire, « la main à la pâte. » Sous le nom d'officiales, d'officiaux, les cuisines royales regorgeaient d'une foule de queux, hasteurs, paiges, souffleurs, sauciers, enfants, sommiers, poulliers,

|
tous gens ayant une besogne définie et réglée par « le chef des broches », seigneur souverain dans les cuisines.
Cependant, antérieurement au treizième siècle, les rois de France n'avaient point déployé un bien grand luxe de cuisine. Très occupés aux guerres lointaines et réduits aux maigres ressources de leur royaume restreint, ils se montraient souvent inférieurs à leurs vassaux dans les fêtes et les banquets. Louis IX ne favorisa point à sa cour les charges culinaires ; il ne faisait guère que suivre en cela l'exemple de son aïeul Philippe-Auguste, dont Brussel nous a fait connaître les modestes dépenses personnelles.
D e la cour l'exemple vint aux classes des nobles et de la bourgeoisie ; chez les nobles, le cuisinier était moins un cuisinier, au sens propre du mot, qu'une sorte de maître d'hôtel, de majordome, ayant la surveillance des valets d'écurie ou de maison, et tenant la main à ce que tout marchât bien. Dans la bourgeoisie, un valet cumulait toutes les fonctions, chambrier, cuisinier, palefrenier :
| Sauras-tu l'eau
du puits retraire, Et mes anguilles escorchier ? Sauras-tu mes chevaulx torchier ? Sauras-tu mes oiseaux lardier ? |
demande un bourgeois au héros du roman du Roi d'Angleterre, qui se présente chez lui pour lui servir de valet.
E t de fait, ni l'une ni l'autre de ces besognes ne nécessitaient des connaissances bien spéciales. Les menus de nos pères n'avaient point atteint cette pointe de raffinement que le luxe des quatorzième et quinzième siècles vit naître et grandir démesurément. Quelques quartiers de viande grossièrement suspendus à de gigantesques landiers, de plantureuses rôties, des coupes pleines de clairet, pour les puissants ; pour les bourgeois, les artisans, les gens d'œuvre, un repas plus frugal composé de laitage et d'œufs, rarement de viande, souvent pris en plein air près de femmes vendant « chauldes oublées [oublies] renforcies, galetes chaudes, eschauldez », au hasard des coins de rue, sans table, sans fourchette, souvent sans pain.
L e quatorzième siècle changea bientôt tout cela : la raison immédiate ne se déduirait peut-être point facilement de l'état des finances au commencement de ce siècle, pourtant le fait est constant. On dîna environ sur les neuf heures du matin, et l'on soupa le soir à cinq heures, dans la plupart des familles nobles ou bourgeoises. Chez les premiers, on cornait l'eau pour annoncer le repas, ce qui doit
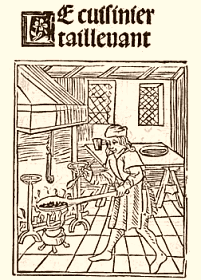
|
s'entendre de la coutume de passer au lavabo avant de se mettre à table ; chez les bourgeois, pour être moins cérémonieux, le repas d'apparat ne laissait point que de donner champ libre aux élégances des riches marchands parvenus et des gens de pécune.
Dès cette époque, on peut affirmer sans crainte d'erreur que le cuisinier n'est plus le manouvrier employé à la rotation des broches, au maniement du balai et au pansement des haquenées. Autour de la table couverte d'une nappe blanche « plissée comme rivière ondoyante qu'ung petit vent frais soulève, ne s'assoient plus de grossiers festoyeurs, de vulgaires gloutons, contents de tout et ne s'inquiétant guère que de la quantité des mangeailles. »
Bien que dînant avec leurs doigts, ces seigneurs savent le prix des raffinements ; ne fait pas qui veut le dellegrout et le karumpie, ces plats aujourd'hui inconnus de nous, et qui furent la base des festins somptueux de ces époques. Et la « lamproye en pasté » avec sa sauce à part, que nous détaille Taillevent, cuisinier de Charles V pendant huit ans, entre 1373 et 1381 ; le saupiquet ou assaisonnement « pour connings et autres rosts » ; le chaudume ou brochet à la sauce au verjus étrangement épaissie de pois en purée ; les entremets de tous genres, comme tartes de pommes, « pastés de poires crues », tartes bourbonnaises faites de « fromaige broyé de cresme et de moyeaux d'œufz. »
Les praticiens se forment à toutes ces exigences de palais raffinés, et il n'est pas sans curiosité de voir, dans la Manière de langage , un gourmet du temps faire lui-même son menu du jour en quittant son lit : « Aions, dit-il à son cuisinier, de bons poissons assés, comme des anguilles, lampreous, saumon... et aussi carpes, bremes, perches, soles..., etc. » Et comme les valets peu habiles ne le servent point à ses désirs, il les tance : « Qu'avez-vous fait depuis que je venois ciens ? Vous ne faites que songer et muser ! Mettez la table tost, et aportez-nous une fois à boire de vin claret ou de vin blanc, car j'en ai grand soif et aussi tres grant faim avecques. »
L e queux est devenu alors un artiste au sens culinaire du mot : il invente, il crée, il diversifie. Taillevent, dont nous avons parlé, laisse un manuscrit composé avant 1380 (les premières éditions de son célèbre Viandier paraissent un siècle plus tard, vers 1490), qui est le monument de ses découvertes gourmandes. D'autres, moins littéraires, et partant moins connus, lui succèdent et portent plus haut encore la bannière de la corporation. La haute bourgeoisie elle-même augmente son luxe, et si des lois somptuaires viennent parfois refréner la passion gourmande, on tourne la difficulté en finançant auprès de monseigneur le roi.
Le Menagier de Paris nous apprend en théorie ce que devait dépenser pour ses convives un bourgeois riche, désireux de faire bien les choses et de régaler ses invités. C'est d'abord la location d'un cuisinier renommé, d'un queux « expert en son mestier », qui, moyennant la grosse somme de deux francs, préparera les mets et payera ses valets
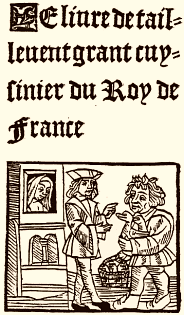
|
de cuisine. Mais comme cet artiste ne descend point aux menues besognes des petits achats et des courses préparatoires, l'amphitryon engagera deux ou plusieurs « écuyers de cuisine », chargés de courir les boucheries et de choisir les meilleurs morceaux.
Puis il faut se procurer aussi les valets servants, deux porteurs d'eau, deux portechapes chargés de « chapeller le pain pour les tranchoirs », des huissiers pour annoncer le nom des arrivants ; enfin, se munir de toute la vaisselle nécessaire au service. Bien que l'on ne changeât guère les assiettes, il était néanmoins indispensable d'avoir « dix douzaines d'escuelles, dix douzaines de petis plas, deux douzaines et demie de grans plas, huit quartes, deux douzaines de pintes et deux pos a aumosnes. »
Comme on le voit, il y avait loin de ces agapes bourgeoises somptueusement détaillées aux maigres chères du siècle précédent. Dans les basses classes de la société, il semble que l'on ait eu aussi un sort meilleur. Dans la Manière de langage, l'auteur peint des paysans s'attablant devant « des chous lardés bien gras et bure ensamble, et aussi du lart et des œfz avec les coques, l'aubun [le blanc] et les moailles [jaune]. » Mais ce doit être par exception, parce qu'il ajoute : « Ils sont si gloutons qu'ils transgloutent sans maschier a cause d'estaindre plus tost leur grant faim. »
Si le quatorzième siècle vit naître l'art de la cuisine et des cuisiniers, le siècle suivant les montre, sinon inférieurs dans leur art, tout au moins bien déchus de leurs anciennes vertus domestiques. Les ruses du métier, les ressources frauduleuses de l'anse du panier, ont trouvé leur cœur ouvert. La Nef des fous, qui, sous une apparence de diatribe exagérée, cache une mordante et juste satire des mœurs du quinzième siècle, nous parle des cuisiniers en ces termes aigres : « Cette tourbe de laquais dont tu vois ici la débauche est la ruine du maître. D'instinct le cuisinier est méchant, et n'a guère de souci de qui le paye. Il n'a d'autorité et ne se gonfle d'orgueil que par notre funeste passion pour la boisson et la nourriture... Tout ce qui s'achète à prix d'or pour la cuisine, le cuisinier le goûte avant le maître et y plonge sa cuiller salie. Aussi ne te laisse jamais dire qu'un cuisinier est mort de faim, sans affirmer qu'il est crevé d'indigestion ! »
http://www.france-pittoresque.com/metiers/51b.htm
Les animaux en
procès
PAR ÉRIC BARATAY
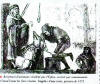
Entre les X11e et XVIIe, siècles, ont
lieu, devant les tribunaux civils, des procès d'animaux domestiques (porc,
cheval...) accusés d'agressivité contre l'homme ou de bestialité avec lui et
condamnés à mort pour édifier la foule, effacer l'infamie. 11 existe aussi
des procédures religieuses contre des grouillements d'animaux sauvages
(insectes, rongeurs, serpents, poissons prédateurs...), envahissant les
côtes et les terroirs, détruisant les récoltes, et contre lesquels les
populations sollicitent l'aide de Dieu et de son clergé. Des procès sont
organisés par les tribunaux des évêques: nomination d'un curateur et d'un
avocat pour défendre des bêtes jugées mineures, échanges de plaidoyers et de
mémoires, envoi d'experts pour évaluer les dommages, accord des habitants
pour concéder un territoire éloigné `afin que les bêtes se nourrissent,
décision d'ordonner aux dites bêtes de s'y rendre sous peine d'anathème
(menace considérée comme une excommunication).
Ces procédures révèlent la persistance d'une notion de communauté des
créatures. L'Église (« l'assemblée », en grec) s'élargit à tous les vivants.
Si les nuisibles disparaissent, c'est qu'ils ont été envoyés par Dieu pour
punir les hommes. S'ils restent, la preuve est faite que le démon les
manipule, ce qui n'étonne guère car les espèces concernées sont souvent
regardées comme ses alliés naturels. L'excommunication les sort de la
société des créatures, les prive de leur pouvoir de nuisance, voire fies
détruit.
La même conception explique les processions du Saint Sacrement dans les
champs pour combattre la « vermine et les exorcismes, accompagnés
d'aspersions d'eau bénite, avec présentation de la Croix.
On légitime ces usages par des
images connues: Dieu maudissant le serpent, Jésus exécrant le figuier ou
exorcisant les porcs, saint Bernard excommuniant les mouches.
Sensible aux attaques protestantes et gagné à l'esprit critique initié par
la révolution scientifique, le clergé des XVII, et XVIIIe siècles refuse
cette fusion du sacré et du profane. se montre hostile aux rites de
protection des troupeaux, exigés par les ouailles (culte de saints, des
reliques, messes pour les animaux, etc.). II devient rétif aux processions
du Saint-Sacrement. Quant aux excommunications il ne croit plus pouvoir en
frapper des créatures sans raison ni baptême.
Profitant de la confusion populaire entre des pratiques mal comprises, le
clergé n'en tolère plus que deux. II s'agit d'abord des bénédictions
préventives des troupeaux, qui assimilent ces derniers aux biens matériels
(maisons, récoltes, navires) bénis eux aussi. Viennent ensuite les
exorcismes des nuisibles, à condition que 1"exorcisme ne frappe pas les
bêtes, non plus considérées comme des membres de l'Église mais comme de
simples instruments du démon. Ce sont les puissances du mal que l'on
repousse. Le prêtre doit se rendre sur les lieux du ravage, se revêtir d'un
surplis et d'une étole, faire le signe de croix, réciter les prières
demandant au démon de s'en aller, bénir les champs, lire les psaumes et
!'Évangile, renouveler les prières et l'aspersion d'eau bénite. Ce type
d'exorcisme est abandonné au XIXe siècle, lorsque la science offre des
remèdes plus efficaces.
revue NOTRE HISTOIRE N°186
Les descriptions du paradis
figurent que la flore. La philosophie occidentale reprendra cette
perspective : concéder des facultés développées à l'animal suppose qu'ils
participent d'une essence spirituelle donc immortelle.
L'animal devient un objet créé pour le bien de (homme et le symbole du monde
matériel
Le christianisme sécularise le statut des animaux leur immolation en faveur
des idoles est interdite ; leur sacrifice est remplacé par la messe, la
transition étant assurée par l'agneau christique ; leur abattage est
transformé en opération profane. Par contre, les interdits alimentaires
judaïques perdurent afin de mieux se démarquer du paganisme. La condamnation
des viandes étouffées, non-saignées, est rappelée en Occident jusqu'au VIIe
siècle, alors que l'explication (« le sang, c'est l'âme ») en est peu à peu
oubliée. La non consommation des animaux impurs est en vigueur jusqu'au
VIIIe siècle, bien qu'elle ait été abolie par le Nouveau Testament. Il n'en
persiste pas moins un fort courant favorable à l'abstinence temporaire des
viandes, qui s'étend dès le VI siècle, malgré que Paul puis des conciles en
ont condamné le principe.
revue histoire n°
En refusant les viandes -nourriture jugée la plus terrestre, la moins
digeste et responsable de désirs immodérés - de nombreux clercs entendaient
libérer l'âme du corps pour penser au spirituel. L'abstinence - notamment le
Carême et le «maigre »,longtemps de rigueur le vendredi - s'inscrit dans le
dualisme matière esprit. Elle conforte l'abaissement de la bête, symbole
d'un monde matériel rejeté, sous-entend le refus de la condition terrestre
et animale. Elle s'efface au XXe siècle du fait de la revalorisation de
l'univers matériel dont on veut s'emparer pour en jouir.
Avec l'abandon des sacrifices, des abattages rituels et des interdits
alimentaires, le christianisme affirme son universalité face au judaïsme.
Surtout, il renvoie l'animal, donc la nature, dans le profane
revue histoire 186 extrait