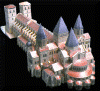http://perso.orange.fr/commanderie.templiers/
http://perso.orange.fr/commanderie.templiers/
COMMANDERIE
Au début du XIIe siècle, les ordres militaires, Templiers* et Hospitaliers*,
édifient un réseau de couvents casernes , particulièrement sur les grands
axes de pèlerinage. En Bretagne, par exemple, les Templiers semblent avoir
cherché de contrôler les itinéraires terrestres et maritimes vers
Compostelle.
Ces commanderies, destinées a loger une garnison, recueillir des aumônes
pour la croisade et héberger les voyageurs, abritent des chevaliers, des
sergents et des chapelains sous la direction d'un «commandeur» nommé par le
Grand Maître (chez les Hospitaliers) ou élu à l'unanimité. Les Templiers ont
adopté la règle de saint Augustin. Chaque semaine, se réunit le chapitre
ordinaire , partout où il y a quatre frères, ou plus, réunis ensemble... ».
Les locaux sont adaptés à la destination militaire et charitable de
l'établissement : de vastes écuries sont nécessaires aux chevaliers; la
chapelle s'inspire de l'architecture cistercienne quand, au milieu du XIIe
siècle, la papauté encourage le ministère paroissial des chapelains. Des
«frères de labour» exploitent la terre, mais leur travail n'est pas la
source d'enrichissement essentielle de ces ordres militaires.
Entre leurs multiples commanderies, les Templiers établissent bientôt un
système
bancaire au service des pèlerins. Ceux-ci confient leurs biens aux Templiers
de leur pays d'origine et, sur présentation d'un reçu «estampillé», ils
obtiennent les versements nécessaires aux différentes étapes et au terme de leur route.
La puissance financière acquise ainsi par les Templiers suscite les convoitises et provoque leur arrestation en 1307.
Elle fait la fortune des Hospitaliers à qui le pape Clément XII
attribue leurs biens en 1312. B.M.
COMMENDE
L'institution consiste à remettre provisoirement en dépôt un bien
ecclésiastique à une personne de confiance en l'absence du détenteur
légitime. Elle est apparue durant le haut Moyen Âge et, en dépit des
réticences conciliaires, les chefs francs et leurs évêques ont alors utilisé
le système à leur profit. Mais c'est du Xe, au XIIIe siècle que la commende
a pris ses caractères spécifiques: elle n'affectait plu, que des abbayes ou
des prieurés -- voir des églises paroissiales - -, mais elle état désormais
conférée à titre viager; le bénéficiaire en percevait les revenus sans
obligation de vie monastique, aussi ses droits de juridiction étaient-ils
limités
Par sa souplesse, la commende tait l'avantage d'assurer la protection des
membres influents du haut clergé d'établissements monastiques par les grands
féodaux. Elle permettait aussi de tourner l'interdiction du cumul des
bénéfices. Cependant, à dater du XIVe siècle, l'exil de la papauté à
amène les pontifes, privés d'une partie de leurs revenus italiens, à
utiliser uniquement la commende pour nantir leurs familiers et les
cardinaux, préludant aux abus ultérieurs.
http://www.instantdurable.com/ID_Maquettes/religieux/cluny.htmCluny
CLUNY
Une nef s'effondre en 1 125 et doit être reconstruite pour être
consacrée une seconde fois par Innocent Il en 113 1. Par la suite, au cours
du XIIIe siècle, un vaste narthex est adjoint à l'édifice et l'édification
de la «galiléen est entreprise vers 1150-1160. Simultanément, Cluny Il doit
céder la place aux agrandissements du cloître. Les chapiteaux qui subsistent
permettent d'imaginer la richesse du décor sculpté (il en aurait existé plus
de mille deux cents!). Ainsi, deux des dix grands chapiteaux du choeur qui
ont été conservés représentent les célèbres «tons de la musique»,
c'est-à-dire les airs sur lesquels se chantent les textes liturgiques.
Ils évoquent l'importance de la musique dans la spiritualité clunisienne.
Science du nombre et de l'harmonie, elle se rapporte aussi à l'architecture
: Gauzon, par exemple, adjoignait à ses talents de bâtisseur une réputation
de musicien accompli. Les sculptures (disparues) du grand portail et les
fresques du choeur (notamment le Christ en majesté à l'abside) ajoutaient
encore à la gloire que les moines de Cluny entendaient rendre à Dieu.
Mais l'abbaye - vendue en 1798 à un marchand de Mâcon - a été détruite entre
1802 et 1816. Toutefois, le prieuré clunisien de Paray-le-Monial, qui a
repris immédiatement (en modèle réduit, évidemment!) bien des traits de
l'abbaye mère, permet de se représenter celle-ci au moment de sa splendeur.
B. M
.PROCÈS DE CANONISATION
Le terme même de canonisation ne semble guère antérieur au XIIe siècle.
Durant le premier millénaire, le culte d'un saint trouve le plus souvent son
origine dans des initiatives locales plus ou moins spontanées, sans enquête
ni jugement. l'évêque, sous la pression des fidèles. élevait ou transférait
les reliques d'un martyr ou d"un confesseur cautionnant ainsi officiellement
le culte publie qui leur étau rendu. Inscrits dans les diptyques de l'église
locale qui détenait leurs reste., les noms de tels saints étaient
progressivement diffusés dans les autres diocèse.,
Ce n'est qu'à partir de 993 que la papauté intervient de temps à autre dans
(a consécration officielle des saints. À la fin du XIe siècle, les papes
s'efforcent de restreindre les prérogatives des évêques en recommandant
l'examen par les conciles, des vertus et des miracles des saints présumés.
Simultanément, ils prononcent de plus en plus (le canonisations de leur seul
chef: Alexandre 111 ( ( 1119-1181 ) porte entre autres sur les, autels
Édouard d',Angleterre, Thomas de Cantorbérv et Bernard de Clairvaux,
Cependant .les évêques ont continue à ratifier la sanction populaire :
divers personnages ont été honorés d'un culte public indépendamment d'une
intervention pontificale bien souvent seulement après coup
Mais à compter de 1234 la papauté se réserve le le droit exclusif de
procéder aux canonisations avec une procédure juridique qui s'est précisée
depuis fa fin du XII e siècle -Elle se met progressivement en place.
Durant quatre jours une vingtaine de témoins déposent sous serinent devant
trois commissaires pontificaux. À partir du XIIe siècle, trois étapes se
succèdent pour vérifier la sainteté d'un candidat à la canonisation. Une
enquête locale à l'instigation d'un évêque ou d'un ordre religieux s'attache
à recueillir les miracles attribués à quelqu'un pour attirer sur lui
l'attention de Rome. Elle est suivie de "l'inquisitio in parthibus
; trois représentants du pape viennent sur place interroger des témoins
de l'existence du futur saint. Enfin, les documents ainsi réunis sont
examinés par la Curie qui élabore un rapport sur la vie et les miracles du
personnage dont le résumé est soumis aux cardinaux réunis en consistoire
autour du pape. Celui-ci rend ou non la sentence de canonisation : selon
André fauchez, plus de la moitié des enquêtes entreprises de 1199 à 1276
tournent court.
La hiérarchie ecclésiastique s'efforce clone de contrôler une conception de
la sainteté jusqu'alors davantage centrée sur le merveilleux : " l'
héroïcité des vertus" prend le pas sur les miracles qui demeurent cependant
considérés connue des révélateurs de la sainteté. A ce titre, ils traduisent
le prestige surnaturel qui s'attache durant le Moyen Âge à tout homme au
destin hors du commun. B. M.
La
Raréfication de l'alleu paysan
La petite et moyenne propriété, qui formait le support économique de la
société carolingienne, disparaît entre Xe et XIe siècle sous la pression des
puissants. La protection de l'État aux petits et aux faibles menacés était
proclamée par les capitulaires, même si elle restait sans doute souvent un
peu théorique; mais elle disparaît avec l'autorité impériale. Le résultat
est impressionnant : autour de Chartres, les alleux donnés à des églises
passent de 80 % des donations autour de l'an mil à 8 % vers 1100 (le reste
étant composé de terres tenues d'un seigneur à un titre ou à un autre). En
Catalogne, 80 % des ventes de terres concernent des alleux à la fin du me
siècle, 10 % seulement dès 1120-1130 : évolution plus tardive, mais plus
brutale. Des critiques radicales ont cependant été portées par Claudie
Duhamel-Amado contre la méthode même de ces comptages : les propriétaires
d'alleux mentionnés dans les textes seraient en fait tous des aristocrates,
que seule l'insuffisance de renseignements à leur sujet empêcherait de
reconnaître comme tels. La disparition des alleux pourrait donc indiquer un
processus de féodalisation, non de paupérisation paysanne. II reste malgré
tout que la société rurale du début du XIIe siècle, dans son ensemble,
paraît composée de tenanciers bien plus que de propriétaires. Bon nombre de
paysans semblent posséder quelques terres, mais la grande majorité n'en ont
pas suffisamment pour vivre, et encore moins pour prospérer et s'affirmer
dans la société.
DIME Lat decima
Commenté par les Pères, sanctionné par les conciles et les décrétales. le
versement à l'Église par les fidèles d'une partie de leurs revenus est
considéré au Moyen Âge comme une institution divine. Le prélèvement varie du
dixième au quinzième (voire moins pour certains produits) au gré des
coutume; locales et des chartes de franchise;. s'y ajoutentles "prémices"qui
représentent le cinquième de la dîme.
Les canonistes médiévaux distinguent les" prediales "qui portent sur les
produits de la terre et de l'élevage (« grosses dîmes » sur les céréales; et
"menues dîmes " sur les légumes, par exemple) et les dîmes personnelles qui
touchent les activités commerciales ou artisanales et dont la validité est
âprement contestée. Les défrichements donnent lieu à la perception de a
navales ».
La dîme. perçue à l'origine en nature par le décimateur, est ultérieurement
convertie en monnaie et le plus souvent affermée à des auxiliaires laïcs,
les "dimiers" , dont la fonction devient transmissible et parfois
héréditaire. La prédication médiévale dénonce, bien entendu, la tendance des
fidèles à frauder et insiste sur les châtiments qui les attendent : les
récalcitrants encourent l'excommunication -BM
DIOCESE
Emprunté à la terminologie administrative de l'Antiquité tardive où il
s'est d'abord appliqué à de vastes circonscriptions civiles mises en place
par Dioclétien (vers 297-298), le mot a durablement été concurrencé, en
Occident, par celui de «paroisse» (purochia) avant que ce dernier ne se
spécialise pour désigner le ressort d'une église paroissiale proprement dite
: la confusion intervient encore chez le canoniste Gratien (mort avant
11591.
L'étendue des diocèses est très inégale. certains sont très restreints,
comme celui de Dol (une quarantaine de paroisses). d'autres sont énormes,
tel celui de Poitiers. Leur répartition ne correspond pu. systématiquement à
la géographie politique : A Lyon le siège se trouve en
terre d'Empire -- est le métropolitain d'évêchés loués en France. De plus,
les limites des circonscriptions prêtent à contestation et certains évêchés.
ont des enclaves chez leurs voisins : Dol contrôle vingt-deux paroisses dans
le diocèse de Saint-Malo et quatre dans celui de Rouen.
À partir du XIe siècle, les modifications ou créations de diocèses ne
relèvent que de la papauté, ainsi que le rappelle Urbain II (1092) à
l'archevêque de Reims. Le pape procède aussi parfois à des suppressions,
comme lors de l'union de l'évêché de Die à celui de Valence, en 1276.
Tout diocèse s'intègre à une province ecclésiastique à la tête de laquelle
se trouve
un archevêque métropolitain. B. M
VEZELAY
Abbaye bénédictine fondée au IXe siècle, et reconstruite au XIe, avec
l'appui des ducs de Bourgogne et des comtes de Nevers, Vézelay devient,
durant le Moyen Age central un important centre de pèlerinage autour
des reliques de sainte Marie Madeleine et le point de départ d'une des
routes vers Saint-Jacques-de-Compostelle, C'est de là qu'en 1146, Bernard de
Clairvaux commence à prêcher la deuxième croisade. L'église de la Madeleine,
construite à partir de 1050 par l'abbé Arthaud et consacrée en 1104, est
représentative de toute une «famille» d'édifices romans en Bourgogne, à côté
de celle issue de Cluny III.
À la suite d'un incendie (1120), l'ancienne nef charpentée d'époque
carolingienne est remplacée, à l'initiative de l'abbé Renaud de Semur, par
une triple nef édifiée entre 1135 et 1140. La limitation de l'élévation à
deux étages (sans triforium) évite de dégager dangereusement les parties
hautes. Les murs sont allégés par l'emploi, sur la nef principale, d'une
voûte d'arête de type plat (confortée ultérieurement par des arcs-boutants).
Le choeur, gothique, apparaît donc ici comme l'« achèvement logique » (Henri
Focillon) de la nef.
Le narthex (achevé en 1150) comprend aussi trois collatéraux qui s'ouvrent
sur les nefs de l'abbatiale. L'étage donne sur la nef par une tribune dédiée
à saint Michel dont la voûte montre la plus ancienne expérience de l'ogive
en Bourgogne.
De riches sculptures, sans doute marquées par l'influence clunisienne,
réunissent toutes les caractéristiques du décor roman. Les chapiteaux de la
nef, exécutés entre 1104 et 1120, laissent une large place aux images de la
vie rustique. Sur le tympan du portail figure un sujet peu fréquent :
l'envoi des apôtres en mission par le Christ des mains de qui partent les
rayons de la Pentecôte. Autour, sur le linteau et dans les compartiments qui
réduisent la surface du tympan figurent les peuples de la terre, accueillis
aux pieds du Christ par saint Pierre et saint Paul. B.M.
VICAIRE GÉNÉRAL
Lorsque l'évêque était appelé à s'éloigner de son diocèse, il a toujours
choisi un homme de confiance pour expédier les affaires courantes. Comme ces
absences se multiplient au cours du Moyen Âge pour diverses raisons
(croisades, voyages ad limina, service du prince), la fonction du vicaire
général tend à devenir permanente, sur le modèle du" procurator generalis
romain. Innocent III en prône la mise en place en France chaque fois qu'un
évêque est empêché. Le système ne sera toutefois généralisé qu'au XIVe
siècle.
Chargé de l'administration du diocèse (à condition de ne pas en aliéner le
patrimoine), le vicaire général voit son sort si étroitement associé à celui
de l'évêque que sa fonction se trouve interrompue par le décès ou la
démission de ce dernier.
VIDAME
Dès le haut Moyen Âge, le vidame (vicedomirus) est un clerc de haut rang,
délégué permanent de l'évêque, qui gère le temporel du diocèse. À l'époque
féodale, il en vient à assurer la protection armée (notamment la conduite à
Post) et exerce parfois des pouvoirs de police fort étendus dont il est
tentant d'abuser. Ainsi, dans les provinces ecclésiastiques de Reims et de
Sens, les vidames deviennent, aux Xe et XIe siècles, des seigneurs laïcs,
souvent détenteurs d'un fief: ils sont à la fois protecteurs armés de
l'évêché et administrateurs des biens épiscopaux.
À partir du XIIe siècle, avec le soutien du roi et de la papauté, beaucoup
d'évêques tentent de restreindre les pouvoirs des vidames, ne leur laissant
que de faibles revenus et de modestes droits honorifiques. B. M.
VIE. ALEXIS
Dès le Ve siècle, une légende syriaque rapportait l'histoire d'un jeune
patricien qui aurait tout quitté, le jour même de ses noces, pour se rendre
à Édesse où il aurait mené une vie ascétique, caché parmi les pauvres
jusqu'à sa mort. Diverses versions ultérieures combinent le canevas initial
et le thème du mariage blanc: le saint, qui s'appelle désormais Alexis, a
été contraint au mariage par sa famille; à l'issue d'un entretien dans la
chambre nuptiale, il obtient de son épouse l'engagement d'une continence
parfaite et d'une fidélité définitive. Il lui remet pour sa part des gages
de fidélité qui permettront de le reconnaître après sa mort,Alors que revenu
parmi les siens,il a vécu de leurs aumônes
Adaptée en
latin à la fin du x, siècle, cette légende a aussitôt connu un énorme succès
dans tout l'Occident. Une chanson en langue vulgaire (vers 1040) met
l'aventure à la portée des milieux aristocratiques à qui ce saint apparaît
comme leur intermédiaire tout désigné auprès de Dieu. La formule « Aiez
senhior » (« Oyez, seigneurs ») de certaines versions annonce la forme des
chansons* de geste qui s'adressent à un public identique. On s'est demandé
si l'ascétisme exalté prôné par la légende n'avait pas contribué, alors même
que l'Église s'efforçait d'imposer un modèle matrimonial chrétien, à
favoriser l'apparition de tendances hérétiques. Toujours est-il qu'en 1173,
la vocation de Pierre Valdo, riche marchand lyonnais à l'origine du
mouvement vaudois, aurait été déclenchée par l'audition de la Chanson de
saint Alexis.
On en a recensé trois réfections successives ainsi que deux autres
traductions indépendantes et diverses traductions en prose. Cette Vie a
aussi été mise en vers provençaux et a fourni le sujet d'un miracle, sans
compter des développements analogues en Italie, en Espagne, en Allemagne et
en Angleterre. B. M.
VILLARD DE HONNECOURT (première moitié du XIIe s.)
 Cathédrale de Laon
Cathédrale de Laon
Ce personnage mal connu était sans doute un expert en bâtiment (peut-être un
clerc passionné d'architecture et de décoration) apte à coordonner les
activités des divers spécialistes intervenant sur les chantiers et de
fournir à chacun des suggestions ou des arrangements.
 dessin de Villard de Honnecourt
dessin de Villard de Honnecourt
Il a légué aux gens de métier un petit carnet (B.N. ms fr. 19093) où sont
consignés notes et croquis fournissant « quantité de renseignements au sujet
de la grande technique de la maçonnerie et des ouvrages de charpente. Et
vous trouverez ici la technique du dessin, le "trait" comme la science de
géométrie le commande et l'enseigne» (trad. R. Bechmann).
Originaire de la petite ville de Honnecourt, en Vermandois, probablement
formé à l'abbaye cistercienne voisine de Vaucelles, Villard témoigne de la
curiosité intellectuelle du XIIIe siècle : il dessine d'après nature ,
s'exprime en langue vulgaire, correspond avec un autre
Picard, son Collègue Pierre de Corbie, à propos de problèmes techniques. II
connaît
incontestablement les modèles antiques,mais s'inspire des édifices
contemporains
qu'il a pu étudier au cours de ses déplacements: les cathédrales de
Lausanne,
Chartres, Meaux, Laon, Reims. Il se rend en Hongrie dont la soeur du roi,
Élisabeth
(morte en 123 I ), a des liens de piété avec la Picardie. Sans doute est-ce
pour le
compte des abbayes cisterciennes qui s'implantent alors dans ce royaume que
Villard y a passé maints jours : certains dallages de celle de Pilis portent
des mo-
tifs décoratifs identiques à ceux qu'il a dessinés. B. M.
VILLE DE FRANCHISE
Agglomération dotée d'une charte énonçant les privilèges ou franchises
concédés par le seigneur, cas très répandu au XIIe siècle. Il paraît
légitime de distinguer les villes de franchise des communes, dans la mesure
où le privilège communal (c'est à-dire le droit de se lier par serment)
existait en dehors des franchises et où Philippe Auguste évitait de
confondre les « gens de ses communes u avec ses « bourgeois ».
Moyennant quoi, les différences n'étaient pas nettes dans le domaine
administratif : il y avait des villes franches aussi libres que des
communes, les unes et les autres pouvaient englober des ruraux ou des
bourgeois travaillant la terre; le droit de bourgeoisie (avoir une maison,
des biens meubles) y revêtait des formes identiques, tout comme les
obligations militaires et le statut personnel. Si les villes de franchise
avaient un prévôt (agent royal), les communes n'y échappaient pas toujours.
C'est le serment qui faisait la différence,
VILLEHARDOUIN,
Geoffroy de (Villehardouin,Champagne, v.1150 - av. 1218)
Geoffroi de Villehardouin était un historien et chevalier croisé du Moyen Âge.
Il est né au château de Villehardouin (Aube, France), situé à 30 kilomètres environ à l'Est de Troyes, entre Arcis-sur-Aube et Bar-sur-Aube, à une date inconnue, entre les années 1150 et 1164. Tout ce que nous savons de lui, avant son départ pour la IVe croisade, c'est qu'il fut sénéchal de Champagne, à partir de 1191. Son fils Erard ayant pris, en 1213, le titre de seigneur de Villehardouin, on peut présumer que cette année là, Geoffroi est mort à Messinople (Mosynopolis), en Thrace.
Villehardouin ne devait jamais revenir en France. En
1198 il fut
nommé par
Thibaut III de Champagne commissaire chargé de préparer et négocier le
transport des Croisés vers la
Palestine
auprès de la
République de Venise
Maréchal du comte de Champagne, il se croise avec son maître en 1199 et il
est l'un des commissaires chargés de négocier avec les Vénitiens le
transfert de l'armée des croisés. À la mort de son suzerain (1200), son
intervention contribue à assurer au marquis Boniface de Monferrat la
direction de cette quatrième croisade.
Ses talents diplomatiques et militaires sont mis à contribution dans le
déroulement des opérations qui aboutissent au détournement de l'expédition
et à la conquéte de Constantinople (1204). Lorsque Baudouin de Flandre est
élu à la tête de l'Empire latin d'Orient, Geoffroy est nommé grand maréchal
de Romanie, c'est-à-dire de tout l'Empire (1205). Boniface devenu prince de
Thessalonique récompense la fidélité de son serviteur en nommant celui-ci
seigneur de Messinople (1207).
C'est probablement après 1208, passé la cinquantaine et retiré de la vie
politique active, que Villehardouin entreprend la rédaction de la Conquête
de Constantinople. Cette chronique qui s'appuie sur des souvenirs précis et
des sources diplomatiques entend justifier le coup de main des croisés
contre un riche Empire chrétien : « Geoffroy, le maréchal de Champagne,
témoigne bien, selon la vérité et en conscience, que, depuis que le monde
fut créé, il ne fut fait tant de butin en une ville. »
VIN
 Malgré
la pression démographique qui pousse à privilégier la production céréalière
les XIe - XIXe siècles voient un grand développement de la viticulture, dû
surtout à la croissance urbaine et à l'augmentation des possibilités de
transport vers les pays du nord de l'Europe. La vigne s'étend d'ailleurs
bien plus loin au nord que de nos jours: Laon est une «capitale du vin»
grâce à sa proximité des villes flamandes; et les vins «de France»,
c'est-à-dire d'Île-de-France, alimentent une capitale en forte croissance,
avec sa cour et son université, et s'exportent en outre massivement par la
Seine. La carte viticole de la France, telle qu'elle est sensiblement
différente de celle qui nous est familière aujourd'hui : elle est modelée en
grande partie par les facilités du transport fluvial ou maritime vers les
paysans consommateurs, ceux surtout de l'Europe du Nord, et aussi par le
goût dominant pour les vins légers (de toute façon, aucun vin ne se conserve
plus d'un an ou deuil. Pour esquisser cette carte des grandes zones
viticoles, on peut suivre La Bataille des vins, fabliau écrit probablement
peu après la mort de Philippe Auguste :
Malgré
la pression démographique qui pousse à privilégier la production céréalière
les XIe - XIXe siècles voient un grand développement de la viticulture, dû
surtout à la croissance urbaine et à l'augmentation des possibilités de
transport vers les pays du nord de l'Europe. La vigne s'étend d'ailleurs
bien plus loin au nord que de nos jours: Laon est une «capitale du vin»
grâce à sa proximité des villes flamandes; et les vins «de France»,
c'est-à-dire d'Île-de-France, alimentent une capitale en forte croissance,
avec sa cour et son université, et s'exportent en outre massivement par la
Seine. La carte viticole de la France, telle qu'elle est sensiblement
différente de celle qui nous est familière aujourd'hui : elle est modelée en
grande partie par les facilités du transport fluvial ou maritime vers les
paysans consommateurs, ceux surtout de l'Europe du Nord, et aussi par le
goût dominant pour les vins légers (de toute façon, aucun vin ne se conserve
plus d'un an ou deuil. Pour esquisser cette carte des grandes zones
viticoles, on peut suivre La Bataille des vins, fabliau écrit probablement
peu après la mort de Philippe Auguste :
les soixante-dix vignobles qu'il recense, on trouve naturellement
l'Ile-de-France, le Laonnois, le Soissonnais et la Champagne, puis la basse
Bourgogne dont les vins d'Auxerre » s'exportent aisément par la Seine; les «
vins de "Beaune " » au contraire, gênés par le manque de communications
fluviales vers le nord-ouest, ébauchent seulement au XIIIe siècle leur
carrière internationale. Suivent les vignobles de Loire, avec des appendices
destinés à disparaître par la sorte, jusqu'en Orléanais et en Berry - outre
les plus estimables crus de Sancerre, de Saint-Pourçain et de Haut-Poitou.
L'approvisionnement de l'Angleterre, d'abord assuré par la vallée du Rhin et
l'Île-de-France, a suscité au XIIe siècle une énorme croissance des
vignobles d'Aunis et de Saintonge, dont la production s'exportait par La
Rochelle; le terrier du grand fief d'Aunis établi en 1246 pour Alphonse de
Poitiers fournit de ce vignoble une image d'une rare précision, alors même
que le débouché anglais s'est réduit. La conquête capétienne de 1224 a en
effet transféré la demande des Anglais vers la dernière région viticole qui
leur appartenait: la Gascogne, à laquelle ils accèdent par Bordeaux. La
Bataille des vins donne ainsi une image vivante de la viticulture médiévale,
qui prospère dans des régions qui lui sont à nos yeux bien peu propices, et
qui alimente largement le commerce fluvial et maritime. Remarquons cependant
que ce texte, oeuvre d'un homme du Nord - probablement un Normand -,
sous-estime certainement la production méridionale, effleurant à peine le
Bordelais et le Languedoc, oubliant la Provence. II est vrai que le
développement des vignobles méridionaux semble plus tardif; dans la plaine
languedocienne, l'essor décisif ne date que du début du XIVe siècle, mais il
est irrésistible, gagnant avant le milieu du siècle le tiers des parcelles
cultivées. C'est aussi à cette époque que la présence des papes en Avignon
développe et améliore les vignobles du bas Rhône. Les vins du Midi ne font
d'ailleurs pas l'objet d'un commerce à longue distance vraiment intense
avant la fin du Moyen Âge, malgré les encouragements des rois de France.
Quant aux vins liquoreux, très appréciés des connaisseurs de ce temps restés
le monopole de la Méditerranée orientale, ce n'est qu'au XVIIe siècle que la
Provence va apprendre briquer le muscat.
Commerce
Sur les marchés locaux, se retrouvent surtout des paysans et des artisans, pour y troquer des denrées agricoles contre des produits ouvrés. Des échanges à court et à moyen rayon se sont d'abord noués, avant que ne s'établissent des relations plus lointaines. Les Flamands ont commencé par vendre leurs draps en Champagne, avant d'y rencontrer les Italiens à partir de 1175 environ. Le commerce à longue distance relie des régions exportatrices (de céréales, de vin, de sel, de laine, de draps), des places importatrices et distributrices de produits lointains (Venise, Pise et Gênes; Bruges et les comptoirs hanséatiques; à un moindre degré les ports de la façade atlantique) et des zones de forte consommation (Paris et ses cent cinquante mille habitants, les villes de Flandre et d'Italie). Les épices et les soieries, produits exotiques, rares et chers, acheminés depuis les lointaines contrées d'Orient et d'Extrême-Orient, symbolisent couramment le commerce médiéval, ses tonnages limités, ses risques et ses profits faramineux. En fait, le commerce des produits de base et des denrées alimentaires a occupé une place essentielle. Dans une longue liste de produits se détachent les blés du Bassin parisien, les vins de La Rochelle, d'Auxerre, de Beaune et de Bordeaux, le sel breton, les harengs de la mer du Nord, les ovins et les bovins, les peaux, etc. II faut souligner que la consommation urbaine est la source de l'essentiel des activités et des profits. Dans les villes flamandes, tenir l'approvisionnement est aussi essentiel que contrôler l'exportation des draps. L'historien belge Van Houtte a même pu soutenir que ce n'était pas le commerce lointain qui avait fait la fortune de Bruges, mais plutôt la nécessité d'approvisionner une population nombreuse. Reste la marchandise par excellence, le drap, ce terme désignant une très grande variété d'étoffes de laine. Le,drap flamand se vend de la Scandinavie à la Terre sainte, y compris en Angleterre, qui n'a pas encore entrepris de transformer sa laine. Rouen vend aussi du drap en Espagne au XIIe siècle et en Italie au XIIIe
Des études récentes ont montré que l'activité commerciale n'était pas réservée aux grands centres. Elle était en fait très répandue et très ramifiée. Vers 1250, Marseille commerçait ainsi avec le Levant, l'Afrique du Nord et l'Italie du Sud, comme le révèlent les registres du notaire Amalric. Dans les petites villes du Forez, de modestes boutiquiers cohabitaient avec d'authentiques marchands et même avec des banquiers. En somme, le tableau du commerce français aux XIIe et XIIIe siècles s'avère plus diversifié que ne le laissent penser les évocations classiques. Le volume global des transactions portant sur les produits de base ne peut malheureusement pas être évalué. H. M.
Les bourgs - les castelnaux
Les traces
écrites des libertés personnelles,accordées plus ou moins généreusement aux
habitants, et à la constitution de communautés autonomes.
de ce phénomène restent cependant assez peu nombreuses, car il est dû
surtout à
l'initiative de seigneurs laïcs de rang moyen, qui n'avaient guère
d'archives;
mats beaucoup de villages actuels conservent dans leur plan la marque de
cette
origine. Les castelnaux présentent au demeurant des formes très simples,
souvent inspirées par le site : le cas le plus courant est celui du
village-rue occupant un éperon, fermé à l'ouest par le château et à l'autre
bout par une porte fortifiée;d'autres castelnaux affectent des formes
ramassées; l'église se trouve un peu à l'écart, et fait pendant au château à
l'est. L'enceinte qui clôt le village peut être simplement constituée par
les murs arrière des maisons. Dans le nord de la Gascogne (Bazadais), Ies;
bourgs castraux sont même restés durablement ouverts.
La plupart des castelnaux sont de très petite taille (quinze à cinquante-
maisons
aux XIIe e siècles malgré le développement qui a souvent amené la création
de faubourgs barris hors de l'enceinte. Mais leur nombre élevé et la
persistance
des formes de vie sociale qui s'y sont façonnées en font une structure
essentielle
de l'habitat gascon. F.M.
CASTILLE (comté,
puis royaume)
Vers 800, le territorium Castellae constitue la marche orientale du
royaume asturo-léonais, au nord de la province de Burgos. Le comte Fernand
Gonzalez (923970) parvient à constituer le grand comté de Castille,
héréditaire sinon pleinement indépendant. Ses successeurs Garcia Fernandez
(970-995) et Sandre Garda (9951017 ou 1021) s'illustrent en luttant contre
al-Mansur. Après 1002, Sanche Garda occupe les terres de Ségovie et de
Sepulveda, la frontière entre la chrétienté et l'islam se trouvant repoussée
à la sierra de Guadarrama. En 1021, la Castille passe sous le contrôle de
Sanche le Grand de Navarre, qui en fait un royaume en 1032 et l'octroie à
son fils Ferdinand, premier du nom (1035-1065). Désormais, la Castille et
Burgos deviennent l'âme de la
chrétienté ibérique reconquérante. H, M,
CASTRUM
Ce mot très couramment employé aux Xe
ET XIIe siècles désigne un
lieu fortifié: il peut s'agir de ce que nous appelons un château fort (plus
rarement désigné par castellum),aussi bien que d'une agglomération
fortifiée, village ou petite ville (seules les cités épiscopales étant
appelées civitas), et aussi, dans des acceptions. plus rares, d'un palais
royal ou d'une abbaye ceints de murs. Les deux sens principaux de castrum
- château et village fortifié -- désignent donc deux réalités assez
différentes, sans que l'historien puisse toujours préciser de laquelle il
s'agit. Dans l'ensemble, les deux acceptions ont une répartition régionale
assez nette, correspondant aux formes différentes qu'affecte l'habitat
groupé: la France du Sud, comme l'ensemble du versant méridional de la
chrétienté latine, a été massivement touchée par le phénomène que l'on
appelle en Italie incastellamento,c'est-à-dire le regroupement et la
fortification de l'habitat
Dans ces régions, pratiquement toutes les agglomérations dépassant la taille
d'un hameau deviennent entre le Xe et le XIIe siècle des castra (mais le mot
peut désigner aussi, moins fréquemment, les châteaux ; on précise parfois
castrum populatum pour désigner le village fortifié. Dans la moitié nord
de la France, en revanche, et particulièrement dans e quart nord-est, le
regroupement de l'habitat aboutit souvent à un village ouvert, et castrum
est plutôt réservé au château. Si dans la basse-cour de celui-ci se massent
des maisons paysannes -cas assez fréquent, comme l'ont montré les recherches
systématiques sur la Champagne - on parlera de burgus castri, ou
simplement de villa (comme pour un village Ouvert),
Cette distribution des sens de castrum n'est d'ailleurs pas rigoureuse : le
mot s'applique à bien des petites villes et a certains villages des régions
septentrionales et il est parfois utilisé même dans le Midi pour désigner de
simples châteaux.
CHAPITRE
Nom donné à la réunion de la communauté monastique («convent» ou «couvent
»), à la suite de l'office de prime (ou de tierce, en Carême), dans la salle
capitulaire pour la célébration de l'officium capituli composé de
divers exercices spirituels dont la lecture d'un chapitre de la règle
bénédictine.
A cette occasion, les religieux délibèrent et prennent les décisions
importantes pour la vie du monastère. C'est là qu'est élu le supérieur à la
mort ou à la déposition du précédent. Deux fois par semaine, le plus
souvent, cette assemblée est suivie du chapitre des coulpes au cours duquel
les moines avouent leurs fautes, dénoncent celles des autres (delatio)
et se font publiquement... chapitrer. B. M.
CHAPITRE CATHÉDRALE
Dès l'Antiquité chrétienne, les évêques s'entourent de clercs qui forment le
presbyterum. Les membres de cette communauté, inscrits sur la «liste
de l'église» (matricula ecclesiae), sont appelés chanoines* par les
conciles mérovingiens. Dans la seconde moitié du vin, siècle, le terme
«chapitre» (capitulum en vient à désigner soit l'ensemble des
chanoines, soit l'assemblée au cours de laquelle ceux-ci écoutaient la
lecture d'un chapitre de la Règle ou de quelque autre texte édifiant.
Dans cette acception confuse, le terme figure dans la Règle de Chrodegang
que la Réforme carolingienne impose à toutes les communautés de clercs qui
ne sont pas moines. L'évêque préside le chapitre, y choisit ses
collaborateurs et le dote d'un patrimoine, la mense capitulaire» que les
chanoines se répartissent en en prébendes* ». La vie communautaire se
relâche rapidement mais ceux-ci continuent souvent de demeurer aux alentours
de la cathédrale où ils sont tenus de réciter les heures tout cil assistant
l'évêque dans son administration.
À la tin du XIe siècle, les efforts de la réforme grégorienne pour restaurer
la vie commune aboutissent à l'institution, dans les campagnes de
collégiales de chanoines* réguliers tandis qu'en dépit de quelques
initiatives d'évêques réformateurs, à Carcassonne et à Maguelone par
exemple, les chapitres cathédraux restent essentiellement composés de
chanoines séculiers. Ceux-ci voient leur statut se préciser du XIIe au XIVe
siècle. Le recrutement s'effectue généralement par coopération de l'évêque
et du chapitre, comme à Sens ou à Lyon. En principe les candidats doivent
avoir vingt-cinq ans et n'être ni serfs ni bâtards. Les familles nobles
cherchent à placer leurs cadets dans les chapitres comme à Lyon où existe le
titre de chanoine comte; pourtant, beaucoup (Chartres, Rouen, Langres)
restent ouverts aux non nobles. Détenteur de sa stalle au choeur, le
chanoine est assigné à résidence (bien que la tendance des papes à placer
leurs favoris aille à l'encontre de ce principe) et incité à la récitation
quotidienne de l'office par une rétribution associée à des jetons de
présence.
Fortement hiérarchisés, les chapitres comportent des dignités électives dont
le nombre varie selon les diocèses: dix-sept à Chartres; huit (seulement) à
Paris. L'ordre de préséance diffère aussi selon les diocèses : le premier
dignitaire est le prévôt à Reims et à Soissons, le doyen à Chartres et
à Bordeaux. I1 touche double prébende, préside son propre tribunal et a
autorité sur les autres élus du chapitre : trésorier. chantre, archidiacre,
écolâtre et chancelier. À Langres, c'est le chantre qui occupe le dernier
rang, alors qu'à Chartres, celui-ci est occupé par le trésorier. Ces
chanoines qui ont «voix au chapitre» sont assistés de nombreux subalternes,
vicaires, chapelains, marguilliers, enfants de choeur, aspirant tous à une
promotion. Des chapelains parviennent parfois, comme à Langres, à former une
petite collégiale au sein du chapitre
Au cours du XIIIe siècle, grâce au soutien de la royauté, les chapitres
voient s'accroître leur puissance politique. Ils jouent de leurs liens avec
la noblesse dont leur membres sont souvent issus contre l'évêque et
s'appuient, le cas échéant si celui-ci contre la noblesse et la bourgeoisie